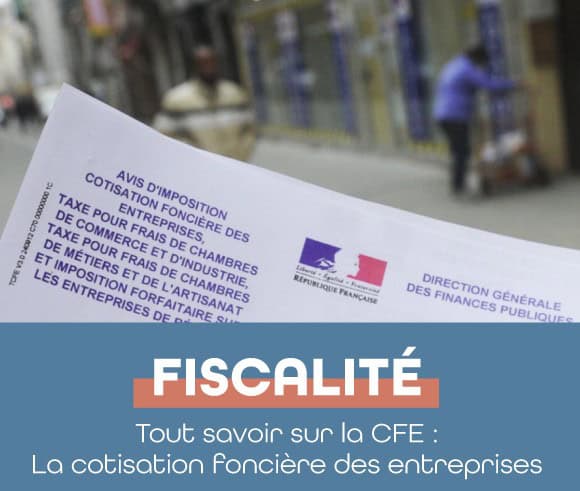
CFE : Tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises
CFE : Tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de cet impôt local peut varier chaque année. On vous explique comment cela fonctionne.
Qu’est-ce que la CFE ?
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par les entreprises. Elle est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE est majorée d’une taxe additionnelle pour permettre le financement des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) pour les entreprises qui dépendent de ces réseaux.
Qui doit payer la CFE ?
La CFE est due par les entreprises, et les personnes physiques qui exercent leur activité en France de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. Les micro-entreprises sont donc concernées par cette cotisation dans les conditions de droit commun.
A savoir :
- Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises mono-établissement dont le montant de chiffres d’affaires ou de recettes ramené ou porté, selon le cas, à douze mois n’excède pas 5 000 € sont exonérées de cotisation minimum.
- Les entreprises nouvellement créées ne sont pas soumises à la CFE l’année de leur création, quelle que soit la date d’ouverture de l’exercice de création.
- Certaines entreprises peuvent être exonérées de CFE. Ces exonérations peuvent être permanentes ou temporaires. Elles sont mentionnées aux articles 1449 à 1466F du code général des impôts.
- La taxe additionnelle à la CFE est due, sauf exceptions, par tous les redevables de la CFE.
Comment est calculée la CFE ?
La base d’imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise au cours de l’année N-2. Par exemple, pour calculer la CFE due au titre de 2023, il faut prendre en compte les biens utilisés en 2021.
La base d’imposition de la CFE peut être réduite dans certains cas, notamment :
- de 30 % pour les établissements industriels (les entreprises concernées peuvent ainsi moduler le montant de leur acompte de CFE pour anticiper cette baisse, avec une marge d’erreur de 20 % exceptionnellement tolérée)
- en proportion du temps d’inactivité, en cas d’exercice de certaines activités saisonnières (restaurants, cafés par exemple)
- pour les artisans employant jusqu’à trois salariés (réduction de 75 %, 50 % et 25 % selon le nombre de salariés dans l’entreprise)
- en cas d’implantation en Corse (abattement de 25 % sur la part perçue au profit des communes).
À défaut de locaux ou lorsque la valeur locative est très faible, la CFE est établie sur une base d’une cotisation forfaitaire minimum dont le montant est fixé par la commune ou l’EPCI en fonction du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en N-2. Le barème de cette cotisation forfaitaire est revalorisé chaque année.
| Montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en N-2 | Montant de la base minimum |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 10 000 € | Entre 237 et 565 € |
| Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 € | Entre 237 et 1 130 € |
| Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 € | Entre 237 et 2 374 € |
| Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 € | Entre 237 et 3 957 € |
| Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 € | Entre 237 et 5 652 € |
| Supérieur à 500 000 € | Entre 237 et 7 349 € |
Source : article 1647 D du Code général des impôts
Le montant de la CFE est égal au produit de la base d’imposition par le taux décidé par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).
La taxe additionnelle à la CFE est assise sur la base d’imposition à la CFE. Son taux dépend de celui voté chaque année par la Chambre de commerce et d’industrie de la Région.
Comment déclarer et payer la CFE ?
Déclaration de la CFE
Vous devez effectuer une déclaration CFE avant le 1er janvier de l’année suivant la création de votre entreprise, à l’aide du formulaire mis à disposition sur le site impots.gouv.fr. Par exemple, si vous créez une entreprise en 2024, vous devrez effectuer votre déclaration avant le 1er janvier 2025.
Vous n’avez pas de déclaration annuelle à effectuer ensuite, sauf si un changement intervient dans votre situation susceptible de modifier le montant de votre cotisation (changement de la surface des locaux par exemple) ou pour informer de la cessation ou de la fermeture d’un établissement). Pour déclarer un changement, vous devez déposer une déclaration 1447-M avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Paiement de la CFE
Si votre cotisation annuelle de CFE N-1 est supérieure ou égale à 3 000 €, et si vous n’avez pas choisi le paiement mensualisé, vous devez régler votre cotisation en deux tranches :
- un acompte égal à 50 % du montant de la CFE mise en recouvrement au titre de l’année précédente : au plus tard le 17 juin 2024
- le solde de la CFE : au plus tard le 15 décembre de chaque année, déduction faite de l’acompte versé.
Plusieurs options pour le paiement de votre cotisation s’offrent à vous :
- l’adhésion au prélèvement à l’échéance sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, service gratuit + prix de l’appel)
- le paiement direct en ligne en cliquant simplement sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis dématérialisé (sous réserve de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel).
Sources : © Economie.gouv – Retrouvez d’autres d’actualités sur le blog de l’Atwo Conseil !
 Votre expert-comptable, booster de projet
Votre expert-comptable, booster de projet
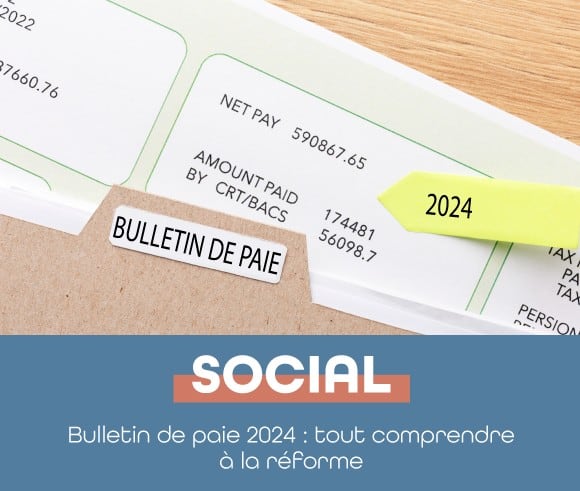
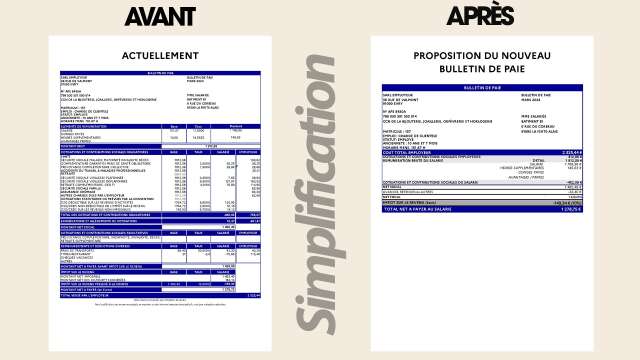

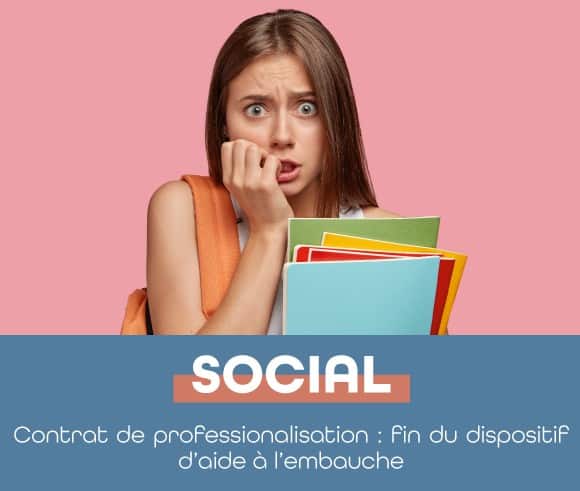


Commentaires récents