Lorsque l’employeur ne maintient pas la rémunération du salarié en arrêt de travail pour maladie, ce dernier n’a pas droit à la prime d’ancienneté conventionnelle liée au versement du salaire réel.
Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-22.190 F-B
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, qui ne perçoit pas de rémunération de l’employeur, peut se voir priver du bénéfice de sa prime d’ancienneté pendant cette période si la convention collective prévoit que celle-ci s’ajoute au salaire réel.
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail, un salarié a été placé en arrêt de travail le 7 mars 2018 puis déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux les 5 et 27 mars 2020. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir un rappel de prime d’ancienneté pour toute la durée de son absence. Demande rejetée tant par la juridiction prud’homale que par la cour d’appel.
Le droit à la prime d’ancienneté
Pour déterminer si le salarié absent pour maladie ou accident a droit de bénéficier d’une prime ou gratification, il convient de s’en remettre aux dispositions fixant les conditions de son attribution (convention ou accord collectif de travail, contrat de travail, note de service, etc.) et, le cas échéant, aux usages en vigueur dans l’entreprise. Le paiement peut être subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise ou bien conditionné à sa présence effective au jour de son versement, voire plus largement à sa présence continue pendant toute la période couverte par le versement de la gratification.
Dans ces derniers cas, la jurisprudence considère que la prime n’est pas due si ces conditions ne sont pas remplies (Cass. soc. 21-10-2020 n°8-24.257 F-D). En l’absence de précision de la convention collective ou du contrat de travail, la Cour de cassation juge en principe que la prime doit être maintenue pendant la période d’absence du salarié. Ainsi jugé dans le cas d’une prime d’ancienneté (Cass. soc. 17-3-1982 n°80-40.167 P).
Aux termes de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, applicable au litige, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l’emploi occupé ; son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
A l’appui de son pourvoi le salarié faisait valoir que cet article 15 ne subordonne pas le versement de la prime d’ancienneté à une condition de présence effective dans l’entreprise ni à la perception du salaire réel. Il précise juste que la prime s’y ajoute. Aussi, la circonstance qu’elle varie avec l’horaire de travail et supporte les éventuelles heures supplémentaires ne permettait pas à la cour d’appel d’en déduire que la prime pouvait être supprimée en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Une position qui s’appuyait sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière (Cass. soc. 1-2-2012 n°10-20.984 F-D ; Cass. soc. 11-5-2016 n°13-27.557 FS-D ; Cass. soc. 8-9-2021 n°20-10.107 F-D : RJS 11/21 n°106).
L’employeur soutenait, pour sa part, que le paiement de la prime supposait le versement d’une rémunération.
La rémunération, critère de versement de la prime d’ancienneté
La chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, refusant à son tour le bénéfice de la prime au salarié.
Pour la Haute Juridiction, s’il ne résulte pas des dispositions de l’article 15 que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée. Autrement dit, le non-versement de la prime n’est pas lié à l’absence du salarié en soi mais à l’absence de rémunération. C’est donc le maintien de salaire par l’employeur qui justifie le paiement de la prime d’ancienneté, les indemnités journalières de la sécurité sociale ne constituant pas une rémunération.
En l’espèce, la cour d’appel ayant constaté que le salarié n’avait perçu aucune rémunération de son employeur pendant toute la durée de son absence, en a exactement déduit qu’il n’avait pas droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant cette période.
A noter : La position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Faisant application de ces dispositions de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979, elle avait déjà jugé que le salarié ne peut prétendre au versement de la prime d’ancienneté pendant ses absences non rémunérées (Cass. soc. 6-12-2017 n°16-17.137 F-D).
Des cours d’appel se sont prononcées dans le même sens dans des affaires similaires où les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient également que la prime d’ancienneté s’ajoutait au salaire réel perçu par le salarié ou en constituait une majoration (CA Versailles 10-6-2021 n°19/02602 ; CA Paris, 14-12-2022 n°20/03822).
La solution aurait été différente si l’absence pour maladie avait donné lieu au maintien de salaire par l’employeur ou si les dispositions conventionnelles avaient prévu que la prime soit due indépendamment de la présence effective du salarié dans l’entreprise. En tout état de cause, il convient de prêter attention, pour déterminer si le salarié a droit au paiement de la prime d’ancienneté pendant son absence, à la rémunération qu’il a pu percevoir pendant cette absence, par application de dispositions légales ou conventionnelles.
Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie remplace les 76 conventions collectives territoriales. L’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ne s’applique donc plus et est remplacé par l’article 142 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Lequel prévoit également que la prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle du salarié et que son montant varie avec l’horaire de travail, supportant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Selon nous, la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 avril 2025 est transposable dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.


 Votre expert-comptable, booster de projet
Votre expert-comptable, booster de projet
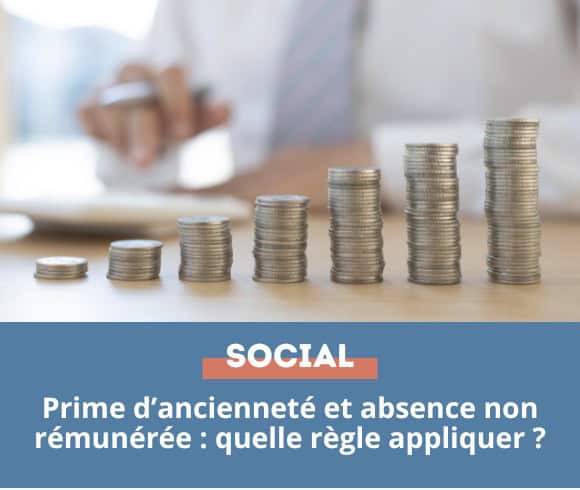






Commentaires récents